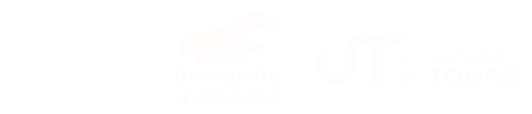Présentation du Contrat de Plan Etat-Région (CPER) 2021-2027
Contrat de Plan État-Région
Centre-Val de Loire 2021-2027
signé entre l’Etat et la région Centre-Val de Loire le 7 mars 2022
Axe thématique n°1 - Renforcer l’attractivité du territoire
4-Recherche et innovation

Le Contrat de Plan État-Région Centre-Val de Loire 2021-2027 a été signé conjointement par Régine ENGSTRÖM, Préfète de la région Centre-Val de Loire, Préfète du Loiret et François BONNEAU, Président du Conseil régional, le 7 mars 2022.
Les orientations du volet recherche et innovation du CPER ont vocation à répondre à l’objectif national de renforcement de la politique de sites, permettant d’intensifier les coopérations entre universités et organismes de recherche, et à accélérer la concrétisation en cours du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (SRESRI) Centre-Val de Loire.
La branche Recherche du CPER est ancrée dans l’objectif national de renforcement de la politique de sites, permettant d’intensifier les coopérations entre universités et organismes de recherche, et d’accélérer la concrétisation du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (SRESRI) Centre-Val de Loire.
Les projets du CPER Recherche visent à décliner en région le caractère structurant des thématiques nationales prioritaires : santé, transition environnementale et énergétique, transformation numérique.
Dans sa construction, le CPER Recherche s’assure de la pluralité des institutions et des laboratoires impliqués, par les liens avec les thématiques nationales et les domaines de la stratégie de spécialisation régionale (S3), ainsi que par la contribution qu’ils apportent à l’équipement scientifique des infrastructures de recherche labellisées nationalement.
En région Centre-Val de Loire, la partie recherche du CPER (2017-2021), est construit autour de neufs projets : REFERENT ANIM, CONEX, DATA CENTER, ESTIM, ORION, PRESTO, VALOPAT, TECHBIOSAN et MUMAT.
Les crédits du contrat de plan assureront la concrétisation d’une partie de ces projets. L’effort d’investissement pourra être poursuivi en mobilisant d’autres ressources complémentaires (FEDER, FEADER, PIA et, plus généralement, des appels à projets régionaux, nationaux et européens).
CONEX (CONecter l’EXpérimentation) : traitement des données environnementales
Partenaires : BRGM, CNRS, INRAE et université d’Orléans
Budget : 6 552 000 €
La majorité des objectifs du programme ont été atteints, malgré quelques ajustements et contraintes budgétaires. Neuf projets d’équipement scientifique ont été réalisés entre 2021 et 2023, améliorant les capacités de recherche dans des domaines clés comme la dépollution, les capteurs ou la géologie.
Ces équipements ont soutenu plusieurs thèses, dont certaines en CIFRE, et renforcé les projets ANR, PEPR, EURAD et PIA4.
Les investissements ont permis des avancées technologiques notables (fibre optique, isotopes, nanostructuration).
Les résultats ont été diffusés via publications, conférences et actions grand public. Le programme a renforcé l’emploi scientifique régional et les plateformes de recherche mutualisées. Une suite est envisagée avec un hub régional d’observation environnementale. Ce hub visera à mutualiser les ressources, améliorer l’interopérabilité et stimuler l’innovation. Il ambitionne aussi de positionner la région comme référence nationale en gestion numérique des données environnementales. Ce projet vise à élargir les partenariats industriels et scientifiques
DATACENTRE : infrastructure régionale de données et de calcul
Partenaires : BRGM, INSA Centre Val de Loire, universités d’Orléans et de Tours
Budget : 3 205 000 €
Le projet vise à mutualiser et sécuriser les ressources numériques des acteurs de la recherche via une infrastructure performante. Les deux premières phases (acquisition et consolidation) sont en bonne voie, et la troisième phase (excellence des services) vient de commencer.
Plusieurs établissements, dont le BRGM et l’Université d’Orléans, ont déjà migré leurs données vers le DataCentre.
Des mesures fortes de cybersécurité ont été mises en œuvre (ZRR, VPN, pare-feux). Le réseau a été modernisé avec des connexions jusqu’à 100 Gbps. Des certifications Tier III et ISO 27001 sont visées d’ici fin 2025. Le DataCentre soutient des projets structurants comme NENUFAR, GaïaData et plusieurs PEPR. De nouveaux services (PaaS, SaaS, outils FAIR) sont en développement. Une gouvernance élargie incluant un comité des usagers sera mise en place dès 2025. Enfin, le projet s’inscrit dans une démarche de sobriété numérique pour limiter son empreinte environnementale.
ESTIM : imagerie en biologie et médecine
Partenaires : CNRS et université d’Orléans
Budget : 1 970 000 €
Le projet n’a connu aucune modification majeure, excepté une hausse des coûts liée au contexte post-COVID. Plusieurs équipements de pointe ont été installés : relaxomètre 3T à champ variable, système d’imagerie SWIR, spectromètre RMN 500 MHz, spectromètre de masse Orbitrap Tribrid, et mise à niveau de l’IRM 7T.
Ces outils renforcent l’expertise en IRM, spectrométrie de masse et imagerie moléculaire.
La plateforme SALSA offre désormais une gamme complète en RMN, spectrométrie, IRM préclinique et SWIR, avec un focus sur la caractérisation de sondes IRM et molécules bioactives. Plus de 19 articles prestigieux ont été publiés en 2024-2025, témoignant de l’impact scientifique. Le projet a permis de financer 6 doctorants (dont 2 CIFRE), 3 post-doctorants, et plusieurs autres personnels. Des collaborations nationales et internationales sont actives, incluant la Ligue contre le Cancer et des programmes ANR, INCa, PHC. De nombreuses actions de médiation ont renforcé la visibilité. Deux dossiers IBISA ont été déposés, dont un lauréat. La plateforme vise à renforcer son offre et à faire de la région un pôle d’excellence en instrumentation analytique.
MUMAT : instruments pour les matériaux innovants
Partenaires : CNRS, INSA Centre Val de Loire, universités d’Orléans et de Tours
Budget : 3 350 000 €
Développer de nouveaux matériaux est un enjeu majeur pour le développement économique de notre Région. La recherche en amont de plusieurs secteurs d’activités doit prendre en compte la demande croissante de matériaux de plus en plus multifonctionnels, robustes afin de répondre aux exigences des nouvelles applications tout en prenant en compte la gestion des ressources premières et l’impact environnemental lié à leur utilisation. Dans la conception de nouveaux matériaux, qui est souvent la brique élémentaire et la clé d’un essor technologique, la maîtrise et la compréhension des étapes d’élaboration, de vieillissement et d’évolution du matériau sont donc primordiales et constituent une voie incontournable pour la définition de nouvelles propriétés et fonctionnalités durables.
Le projet MUMAT concerne les matériaux avancés modernes ou de prochaine génération avec dans leur structuration un degré toujours plus accru de complexité, nécessitant des moyens de caractérisation de plus en plus performants et pointus. MUMAT entend mettre en avant un parc expérimental avec des instruments de pointe, uniques à l'échelle nationale voire internationale, destinés à l'élaboration et les caractérisations macro et microscopiques de matériaux au sens large, y compris en conditions extrêmes.
Le projet MUMAT est doté de 1 760 000 € de financement Etat dont 900 000 € provenant du budget opérationnel de programme (BOP172), le reste éventuel étant la part des organismes de recherche et de 1 590 000 € de la Région CVL.
ORION : observatoire astronomique de Nancay
Partenaires : BRGM, CNRS, Observatoire de Paris, université d’Orléans
Budget : 1 935 000 €
Le projet a permis la mise en place d’une infrastructure dédiée au traitement, au stockage (jusqu’à 3,3 Po) et à la diffusion des données du radiotélescope NenuFAR. Les données brutes (jusqu’à 109 Po/an) sont réduites par un facteur 100 au Centre de Données de Nançay.
Un système de stockage de 3,1 Po y a été installé dès 2021. Les données sont ensuite transférées via l’Observatoire de Paris au NenuFAR Data Centre (BRGM), doté d’un cluster HPC (2024) et bientôt d’un calcul cloud (2025). Le projet EXTRACT (2023-2025, Horizon-Europe) intègre ORION-CVL pour développer des solutions cloud de traitement distribué. L’expérience acquise a permis à l’Observatoire de Paris d’obtenir un financement de 608 k€ pour le cas d’usage TASKA.
Le projet prépare aussi l’intégration de NenuFAR au futur radiotélescope SKA via l’infrastructure nationale SRCnet. ORION a également anticipé la connexion de NenuFAR au réseau international LOFAR2.0 prévue en 2026. Le projet a été ralenti par des contraintes RH, résolues fin 2024. Des présentations scientifiques ont été faites lors de conférences nationales et internationales.
PRESTO : plateforme pour la combustion et la mécanique des fluides
Partenaires : INSA Centre Val de Loire, universités d’Orléans et de Tours
Budget : 753 000 €
Le projet est structuré autour de 9 opérations et a permis l’acquisition d’équipements de pointe pour renforcer deux plateformes clés à l’INSA Centre Val de Loire : Maîtrise des Risques Industriels et Informatique & Intelligence Artificielle.
Parmi les équipements majeurs figurent un DMTA, un dispositif H₂, des outils de métrologie optique, et un simulateur quantique. Malgré un retard logistique sur l’opération liée au calculateur quantique, le projet s’est déroulé globalement sans encombre.
Deux doctorants, deux post-doctorants et un stagiaire ont été impliqués. Des résultats ont été présentés lors de conférences et soumis à des revues scientifiques. Trois projets ANR ont été déposés, et un contrat industriel a été établi. Le matériel soutiendra dès 2025 le projet HAPPIS sur la sécurité hydrogène. Des visites, démonstrations et séminaires ont renforcé la visibilité du projet. Un reliquat de budget pourrait être réaffecté à l’amélioration de la métrologie optique
REFERENT ANIM : analyses génétiques en sciences animales
Partenaires : CNRS, INRAE et université de Tours
Budget : 7 366 000 €
Le projet a réalisé la rénovation et l’extension de ses infrastructures, incluant une animalerie axénique/gnotoxénique unique en France, essentielle pour les recherches sur le microbiote.
Un nouveau laboratoire de confinement de niveau 2 a été créé pour manipuler des pathogènes humains et des tissus. Les travaux immobiliers, financés à hauteur de 1,5 million d’euros par le CNRS, se sont achevés en juin 2024. Les équipements spécifiques, financés par le CPER et par autofinancement, assurent la mise en œuvre opérationnelle.
Ces infrastructures renforcent la visibilité et les capacités scientifiques du TAAM dans la santé humaine. Elles permettent l’étude des infections et des pathologies humaines en conditions sécurisées. Le TAAM participe au projet national GNO-TANIMA, réseau de plateformes en gnotobiologie dédié au microbiome. Ces nouvelles installations sont ouvertes aux acteurs académiques et industriels. À moyen terme, des équipements complémentaires seront nécessaires pour enrichir l’offre de services analytiques et d’imagerie.
TECHBIOSAN : biomarqueurs en santé humaine et animale
Partenaires : CHRU de Tours, INRAE, INSERM et université de Tours
Budget : 3 824 000 €
Le programme initial a été suivi avec plusieurs acquisitions majeures : modernisation du laboratoire L3 de l’UMR INSERM MAVIVHe (2021-2022), équipement d’un microspectromètre confocal fluorescence/Raman en 2023, et achat en 2024 de deux spectromètres de masse pour la plateforme PMAC.
Un nouveau séquenceur d’ADN est en cours d’acquisition via une demande de subvention. Le laboratoire L3 a permis des avancées en virologie, notamment la participation à un essai clinique Covid-19, de nombreuses publications, et le recrutement de chercheurs.
Le microspectromètre confocal a initié une thèse et ouvrira la voie à des recherches innovantes en bioanalyse. Les spectromètres de masse renforcent la métabolomique et lipidomique avec des collaborations nationales et industrielles. Des projets collaboratifs et actions de communication sont en cours pour valoriser ces équipements. Les suites prévoient un report de l’équipement du nouveau L3, une révision du financement FEDER, et une redéfinition des besoins pour un imageur luminescence.
VALOPAT : valoriser les données du patrimoine culturel et naturel
Partenaires : CNRS, INRAE, université d’Orléans et de Tours
Budget : 6 016 000 €
Le projet VALOPAT s’intéresse aux patrimoines naturels et culturels et s’axe autour de 3 enjeux :
- Améliorer la collecte de données in situ sur les patrimoines naturels et culturels au travers d’un dispositif modulaire de terrain constitué d’éléments nomades (laboratoires embarqués, flotte de drones, dispositifs modulaires d’accès à la canopée) permettant de déployer sur site un ensemble de pièges entomologiques à interception, de capteurs éco-physiologiques, biophysiques, climatiques, thermographiques, topographiques et topo-bathymétriques, d’enregistreurs visuels, acoustiques et géophysiques, et de bio-analyseurs de terrain.
- Développer des programmes de surveillance de la biodiversité avec la mise en œuvre et la maintenance de ces systèmes de surveillance passive, composés de capteurs automatisés de plus en plus performants (portabilité, miniaturisation, autonomie, coût), adaptés à une diversité d’usages et de contextes (capteurs portables, implantés dans le milieu ou embarqués sur des engins mobiles), pour offrir de meilleurs rapports coût-bénéfice que l'observation traditionnelle sur le terrain.
- Consolider la constitution des corpus numériques, relevant du patrimoine culturel et constitués d’objets écrits (textes manuscrits et imprimés, cartes, nouveaux modes d’écritures...), oraux (langues, musique, enregistrement sonores, vidéo...) et matériels (artefacts archéologiques, monnaies...) en poursuivant les interactions disciplinaires entre les SHS et l’informatique et en maintenant un haut niveau de capacité d’acquisition.
Le projet VALOPAT est doté de 2 710 000 € de financement Etat dont 1 850 000 € provenant du budget opérationnel de programme (BOP172), le reste éventuel étant la part des organismes de recherche et de 3 306 000 € de la Région CVL.